Le JDPLS forme une nouvelle génération de chercheur·euses
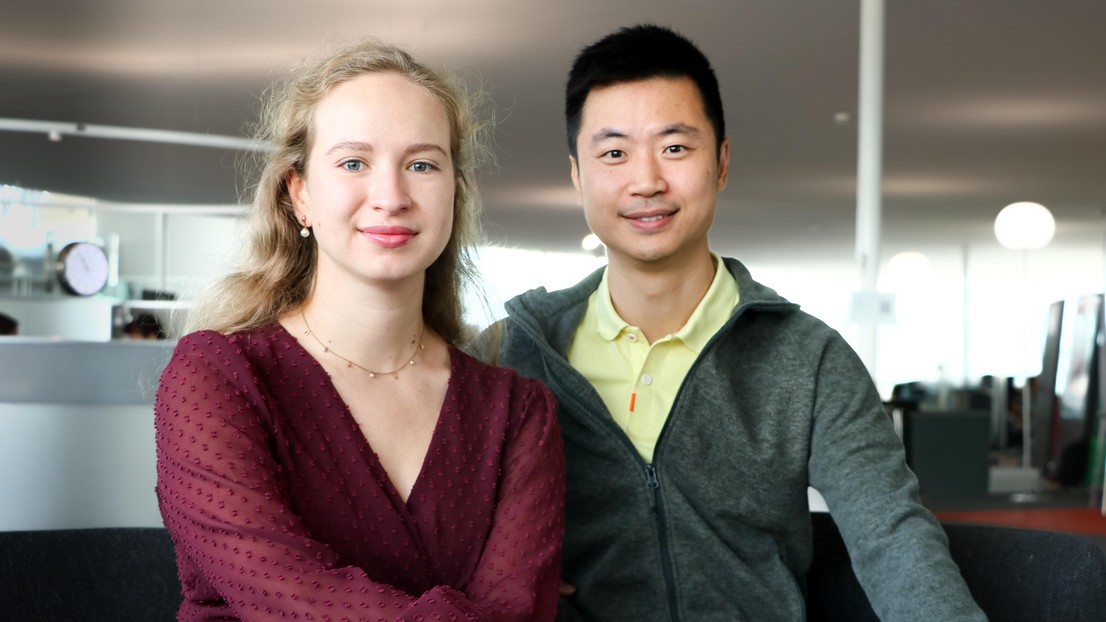
Kate Shved et Zhenyu Cai font partie de la première volée du programme doctoral en sciences de l'apprentissage - Julie Clerget © 2025 EPFL
Quatre ans après son lancement, les membres de la première volée du programme doctoral en sciences de l’apprentissage (JDPLS) proposé conjointement par l’EPFL et l’EPFZ, s’apprêtent à apporter la touche finale à leurs thèses et recevront dans la foulée un diplôme un peu spécial, orné des logos des deux institutions.
A cette occasion, deux de ces doctorant·es pionnier·ères, Zhenyu Cai et Kate Shved, ainsi que le Dr Roland Tormey, co-directeur de thèse et directeur du Centre d’appui à l’enseignement de l’EPFL livrent leurs perspectives sur les premières années de ce programme interdisciplinaire et son impact sur la recherche en éducation en Suisse et au-delà.
« Je supervise deux doctorant·es ici à l’EPFL et co-supervise une doctorante à Zurich. J’enseigne une partie de la matière au programme et j’aime à penser que j’étais impliqué dans les conversations initiales sur ce que pourrait devenir ce programme et comment il s’articulerait » partage Roland Tormey, sociologue et pédagogue expert en formation des ingénieur·es.
Pour lui, ce programme doctoral unique en son genre se caractérise par son interdisciplinarité. « Il aurait pu s’intituler Éducation Numérique ou Recherche en Éducation STIM mais « Learning Sciences » constitue une distinction importante et une tentative de capturer sa nature interdisciplinaire ». Il rappelle que tout a commencé dans les années soixante à l’intersection de l’informatique et des sciences cognitives avant de progressivement s’élargir et d’englober aussi l’anthropologie, la sociologie et bien d’autres disciplines encore. « Les sciences de l’apprentissage en tant qu’espace interdisciplinaire vivant dépendent des disciplines que l’on y intègre et c’est cet aspect qui les rend si passionnantes et stimulantes. Des étudiant·es en microtechnique sont assis avec des architectes et des enseignant·es du primaire et tous·tes prennent part à la conversation. Nous ne nous contentons pas d’étudier l’éducation, nous le faisons tout en réfléchissant de manière critique à notre propre apprentissage. »
C’est précisément cette approche plurielle qui a poussé Zhenyu et Kate à entamer un doctorat au sein de ce tout nouveau programme. Zhenyu mène sa recherche sous la supervision de Roland Tormey et de Pierre Dillenbourg au sein du laboratoire de ce dernier, spécialisé dans les interactions humain-ordinateur. Son parcours s’est d’abord orienté vers l’ingénierie électronique mais très rapidement sa passion pour l’enseignement, qu’il attribue à l’un de ses professeurs d’école, le rattrape. Il démissionne et poursuit un master en technologies éducatives à Pékin qui le conforte dans sa nouvelle direction et rejoint finalement le JDPLS.
Pour Kate, qui effectue ses recherches au sein du laboratoire d’Apprentissage Machine pour l’éducation sous la supervision de la professeure Tanja Käser, c’est aussi un changement de cap qui l’amène à Lausanne. Étudiante en chimie, elle entame même un doctorat dans la branche. Mais force est de constater qu’elle préfère enseigner la chimie plutôt que de l’étudier. « Faire un doctorat est un parcours difficile et si l’on n’aime pas vraiment ce que l’on fait, cela peut devenir très pénible. J’aimais davantage expliquer la chimie que la pratiquer. Quand j’ai découvert ce programme, tout a pris son sens: je me suis dit que c’était exactement ce que je cherchais ».
Zhenyu développe des tableaux de bord d’analyse de l’apprentissage pour aider les enseignant·es universitaires à mieux accompagner leurs étudiant·es lors des séances d’exercices. De son côté, Kate forme des apprenti·es chimistes en leur transmettant des stratégies d’enquête à travers des simulations, afin de faciliter leur adaptation aux laboratoires.
Différents publics, différentes disciplines, différentes approches, mais une même vision : refléter la richesse et la diversité qui font l’ADN de ce programme.
Pour Tormey, superviser ce type de projets qui s’articulent sur deux institutions et plusieurs disciplines consiste à trouver un moyen de parler le même langage. « Nous avons différentes disciplines qui utilisent différentes méthodes de recherche, alors à quoi ressemble un doctorat dans ce domaine ? Cela demande du travail pour mettre en place quelque chose qui soit cohérent et cela demande du travail de la part de l’étudiant·e pour pouvoir maintenir cette cohérence. Nous devons nous aligner et au final, ils et elles apprennent beaucoup et en retirent beaucoup de bénéfices. »
Au niveau de l’EPFL, ce programme doctoral joue aussi un rôle important. En formant des chercheurs et des chercheuses à l’intersection des sciences et de l’éducation, il produit un impact concret sur les pratiques pédagogiques. « L’impact ne se mesure pas seulement en citations et en publications et à l’EPFL nous avons besoin de la recherche en pédagogie pour améliorer nos pratiques » souligne Tormey.