Le labo qui mène la vie dure aux micropolluants
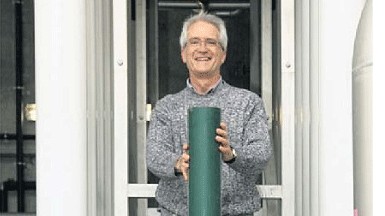
© 2011 EPFL
Doté d’outils de pointe pour l’analyse chimique d’un grand nombre de substances et le séquençage de l’ADN, le Laboratoire central environnemental (GR-CEL), traque les toxiques disséminés dans la nature. Il est aussi une plateforme offrant différents serevices aux chercheurs.
Un labo au service des autres labos. Tel est le rôle principal du GR-CEL, le Laboratoire central environnemental. Felipe de Alencastro, maître d’enseignement et de recherche, qui en est le directeur, le décrit d’ailleurs avant tout comme «une plateforme, offrant différents services d’analyse aux chercheurs de l’EPFL et de l’extérieur.»
Le GR-CEL comprend deux entités : l’une d’analyse chimique, une autre spécialisée dans la biologie moléculaire. La première, dirigée par Felipe de Alencastro, a principalement pour tâche de mesurer les concentrations de micropolluants organiques et inorganiques – pesticides, résidus de médicaments, polychlorobiphényles (PCB), métaux lourds, anions et cations – présents dans toute sorte d’échantillons environnementaux. Le labo dispose d’équipements modernes permettant de traiter des échantillons de sols, d’eau, ou de divers matériaux, afin d’en déterminer la composition, leurs niveaux de contamination, ainsi que plusieurs autres propriétés physico-chimiques.
Un but, deux méthodes
Antibiotiques, antidépresseurs, détergents, pesticides: toutes ces substances consommées par la population se retrouvent, à terme, dans les eaux usées. Or, seuls 40% de ces micropolluants sont, à ce jour, stoppés par les filtres des stations d’épuration (STEP) les plus modernes. Le reste se retrouve dans les cours et les plans d’eau et perturbe dangereusement l’équilibre de la faune et de la flore.
Souhaitant faire passer le taux d’élimination de ces toxiques à au moins 80%, la Confédération a mandaté le GR-CEL pour le suivi analytique des essais pilotes effectués avec deux méthodes différentes d’élimination des micropolluants sur le site de la STEP lausannoise, à Vidy. L’une consiste en un processus d’ozonation, qui dégrade les molécules polluantes par oxydation. L’autre est basée sur du charbon actif en poudre fine, sur laquelle se fixent les substances nocives. Les résultats de cette étude ont montré que les deux procédés sont efficaces et réalisables à grande échelles dans une STEP.
Une machine sophistiquée
«Tous les échantillons issus des tests menés à la STEP de Vidy sont passés par là», explique Dominique Grandjean en montrant le fonctionnement de l’appareil de chromatographie liquide couplé à la spectrométrie de masse, dont dispose le laboratoire. «Il faut dix minutes pour traiter un échantillon et environ une heure pour en obtenir l’interprétation informatique.»
Quelques bandelettes…
Recherche ne rime pas forcément avec matériel de pointe et coûts élevés. La preuve : un projet de mesure de la présence de PCB dans le lit de la Venoge a pu être mené avec des bandes de plastique (du polyéthylène) attachées sur des barres de fer.
Ces capteurs ont été placés durant huit semaines dans le lit de la rivière sur un tronçon de 26 km entre La Sarraz et le Léman et analysés ultérieurement. «Dans ce cas, le polyéthylène était idéal, car les molécules de PCB se fixent facilement sur sa structure poreuse», explique Julien Omlin, qui fait son travail de semestre sur le sujet.
Composés chimiques très utilisés au XXe siècle surtout comme huiles de transformateurs et condensateurs électriques, les PCB sont aujourd’hui présents un peu partout dans la nature. Or, ces polluants difficilement dégradables s’accumulent dans le corps des êtres vivants, où ils agissent entre autres comme perturbateurs endocriniens.
«Un champ d’investigation gigantesque»
Le service d’analyse en biologie moléculaire est chargé d’identifier les micro-organismes - bactéries, champignons, levures - à l’œuvre dans un environnement donné, et de comprendre de quelle manière ces minuscules organismes s’organisent et se développent dans leurs habitats respectifs. Et notamment de trouver lesquels sont capables de dégrader tel ou tel polluant.
«Grâce à de nouveaux outils de pointe, le domaine de l’écologie microbienne est en plein boum. Ce métier change drastiquement et nous avons désormais un champ d’investigation, une puissance analytique, qui sont devenus gigantesques. Cela procure une impression étrange, comme celle qu’a dû ressentir Darwin lors de son voyage aux îles Galapagos», s’enthousiasme Pierre Rossi, collaborateur scientifique, qui chapeaute cette partie du labo.
Petit voyage dans le temps
«Une image du passé est enfermée dans ce bloc…» A ces mots, Alexandre Bagnoud a les yeux qui brillent. Avec Manon Frutschi, laborantine, ce doctorant du Laboratoire de microbiologie environnementale (EML) a pour tâche d’extraire et analyser l’ADN des bactéries contenues dans un bloc d’argile formé il y a… 170 millions d’années! «L’une des difficultés est de s’assurer que nous travaillons dans des conditions parfaitement stériles, afin que les bactéries d’aujourd’hui ne contaminent pas celles d’hier», décrit Manon Frutschi.
Cette roche, exceptionnellement stable et imperméable, prélevée dans le Jura, est pressentie comme un site potentiellement idéal pour le stockage de déchets radioactifs à très long terme. «Notre but, explique Alexandre Bagnoud, est d’observer la nature de ces micro-organismes, leur interactions avec d’autres bactéries, et de déterminer s’ils risquent de compromettre la stabilité de la roche, et donc des fûts de déchets, en produisant du sulfure, qui est très corrosif.»