Face au stress, les mouches s'unissent
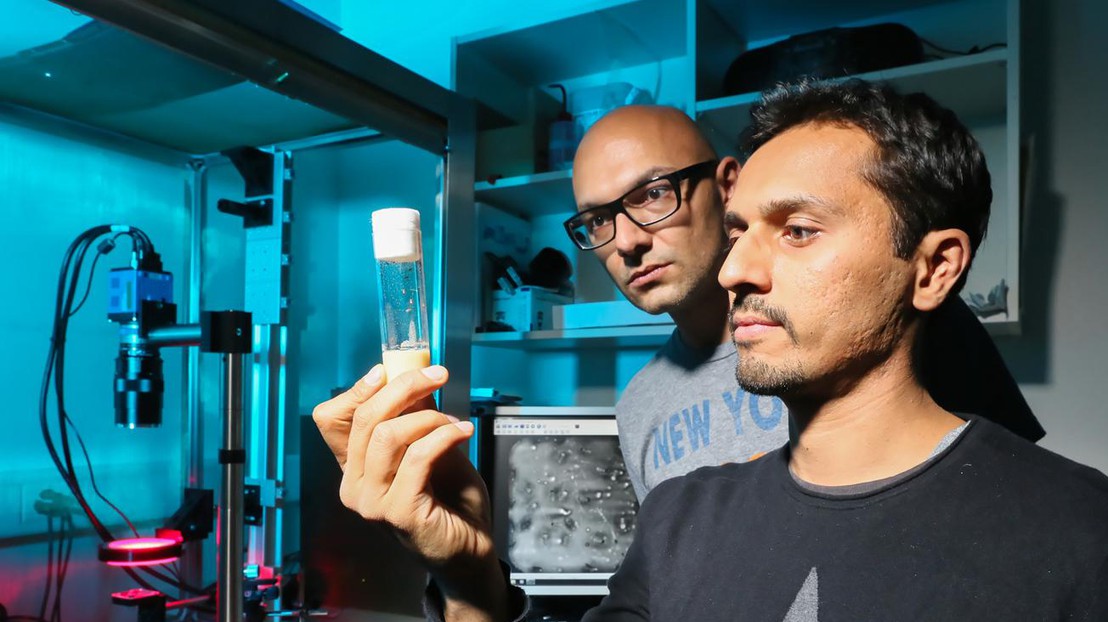
Steeve Cruchet, technicien et Pavan ramdya © 2014 Alain Herzog
Les mouches drosophiles répondent plus efficacement au danger lorsqu’elles sont en groupe. Une équipe de l’EPFL et de l’UNIL a découvert ce comportement ainsi que les circuits neuronaux par lesquels passent l’information, ce qui ouvre un nouveau champ de recherches. Un article paraît aujourd'hui dans Nature.
Les mouches exposées en groupe à un signal de stress adoptent un comportement plus adéquat que les insectes isolés, ont constaté des chercheurs de l’UNIL et de l’EPFL. Ces diptères généralement solitaires, interagissent de manière à générer une réponse collective cohérente. «Les interactions au sein du groupe augmentent leur sensibilité à l’environnement, ce qui facilite leur prise de décision», note Pavan Ramdya, premier auteur d’un article qui paraît aujourd'hui dans Nature.
Pour découvrir ce comportement, les chercheurs ont commencé par quantifier les stratégies d’évitement en présence de CO2. Ce gaz, inodore pour les humains, représente un signal de danger pour les mouches. Une drosophile seule cherche peu à éviter cette odeur aversive. En groupe, quelques secondes suffisent pour qu’une proportion importante de mouches ait quitté la zone.
Même privées de leur odorat, les mouches en collectivité avec des congénères non modifiées, continuent de partir rapidement vers le bon air pur. Le génome de la drosophile étant entièrement séquencé, une base de données comprenant également des mouches génétiquement modifiées est disponible. Il est donc possible pour les scientifiques de choisir certaines caractéristiques comme l’absence de gènes olfactifs.
En observant les mouches, les chercheurs ont constaté que ce comportement de groupe était précédé de nombreux rapprochements entre les insectes. Plus précisément, de petites touchettes sur les pattes qui renforcent le comportement d’évitement. Un contact qui prend l’allure d’un véritable code de communication puisqu’il donne également la direction à suivre. Une touchette sur la patte droite de sa congénère et celle-ci s’en va à gauche. Une touchette à gauche et elle part à droite.
Une mouche-leader fait-elle autorité pour indiquer la route à suivre ? Nullement. Une cascade de contacts identiques suffit. Un peu à l’image des boules de billard : l’impulsion est donnée dans une direction précise. Les insectes touchés partent à leur tour en «avertir» d’autres et ainsi de suite.
Restait à découvrir le circuit neuronal en jeu dans ce comportement collectif. Les données précédentes de l’étude, soutenue financièrement par le Fonds national suisse (FNS), le Conseil européen de la recherche (ERC) et le Human Fontier Science Program (HFSP), suggéraient un rôle essentiel de récepteurs situés sur les membres. Grâce à différentes méthodes, notamment en rendant inactifs tour à tour les groupes de neurones sensoriels de la patte, les chercheurs sont parvenus à localiser les neurones importantes pour détecter le contact.
Situé tout au bout du membre, un petit groupe de neurones sensibles à une déformation mécanique est apparu comme la condition sine qua non à ce comportement social. Les mouches dont cette zone avait été rendue insensible par modification génétique se comportaient comme des individus isolés.
«Alors que les circuits neuronaux contrôlant les interactions entre deux individus comme les parades nuptiales ou les combats, sont de mieux en mieux connus, nous ne savons encore pas grand chose de ce qui orchestre les comportements au niveau du groupe», note Pavan Ramdya. L’identification de voies sensorielles qui régissent une réaction collective chez la drosophile pourrait permettre de mieux comprendre les dynamiques d’autres groupes d’animaux comme les bans de poissons, les oiseaux migrateurs, et même les foules humaines, ajoute-t-il.
